Pour mieux saisir l’importance et l’évolution de contrôle de gestion on se pencher dans ce qui suit sur l’étude de cas de l’entreprise cellulose qui se trouve à Sidi Hya Lgharb Fabricant exportateur de la pâte à papier et on s’intéresse sur l’analyse des écarts et des coûts préétablie pour avoir est ce que l’entreprise réalise vraiment ses prévision ou non, et aussi les outils de contrôle de gestion pour attirer et ressortir les résultats et les analyses sur la pratique de cette fonction et leur rapport avec la performance des entreprises.
Encore de nos jours, un grand nombre de petites et très petites entreprises (PTPE) n’ont pas de véritable système de contrôle de gestion, ou tout au plus quelques éléments de calculs analytiques sommaires et insuffisants.
Mais pour quelles raisons ? Comment cela est-il possible ? La raison principale semble avant tout provenir de l’idée très répandue dans le milieu des PME que le contrôle de gestion n’est utile et ne s’applique qu’aux grandes entreprises. Mais pourquoi cette certitude est elle si profondément répandue chez les dirigeants de PME ?
La première raison qui vient à l’esprit, est le fait que la grande majorité des méthodes et outils de contrôle de gestion enseignés – que ce soit dans les milieux universitaires ou en formation professionnelle concerne pour l’essentiel les grandes et moyennes entreprises.
Dans la problématique du contrôle de gestion ; l’efficacité d’un produit, d’un responsable ou d’une entité est sa capacité à contribuer aux objectifs de l’organisation dans son ensemble. Un aspect essentiel de l’évaluation de la performance d’une entité consiste donc à identifier l’impact que son action a eu sur la performance de l’entreprise.
Le système de contrôle de gestion inclut tous les systèmes d’analyse et de contrôle qui vont permettre de donner aux organes de commande l’information pertinente sur l’exploitation de l’entreprise en fonction des particularités du système et sur la réalisation des objectifs et l’évaluation d’une action.
On peut avancer que le rôle du contrôle de gestion est le même dans les grandes Entreprise que les PME voir plus important du fait de faible traitement de l’information par rapport aux grandes Entreprises. Cependant, il s’agit d’un contrôle de gestion moins formalisé plus par exception lorsque les difficultés surviennent.
Dans la plupart des PME, il n’y a pas de services spécifiques de contrôle de gestion les travaux decontrôleur de gestion sont souvent réalisés par les services comptables ou la direction financière s’ilexiste.
Pour mieux saisir l’importance et l’évolution de contrôle de gestion on se pencher dans cette article sur l’étude de cas de l’entreprise cellulose qui se trouve à Sidi Hya Lgharb Fabricant exportateur de la pâte à papier et on s’intéresse sur l’analyse des écarts et des coûts préétablie pour avoir est ce quel’entreprise réalise vraiment ses prévision ou non, et aussi les outils de contrôle de gestion pour attirer et ressortir les résultats et les analyses sur la pratique de cette fonction et leur rapport avec la performance des entreprises.
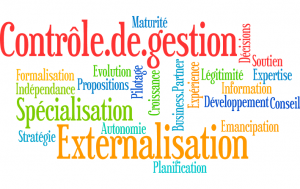
Le contrôle de gestion : cadre théorique
A l’origine, le contrôle de gestion s’est développé au sein des entreprises pour répondre au besoin des dirigeants de mieux maîtriser la gestion, compte tenu des contraintes organisationnelle, à d’évaluer ses performances.
Pour délimiter la définition et le champ d’analyse du contrôle de gestion, il semble nécessaire de resituer les motifs d’apparition du contrôle, les contraintes de la gestion des entreprises et le contexte économique. Il en ressort alors les missions actuelles demandées au contrôle et au contrôleur de gestion.
Comme nous l’avons vu précédemment, un grand nombre de petites et très petites entreprises (PTPE) n’ont pas de véritable système ou service de contrôle de gestion. Cependant, certaines ont parfois franchi le pas, non sans difficulté.
En effet, parmi ces dernières, une majorité de leurs dirigeants ne semble pas toujours très contente des services de leur contrôleur de gestion, et lui reproche notamment :
- L’absence ou l’inefficacité des outils d’aide à la décision proposés.
- Une disponibilité insuffisante pour des études ponctuelles urgentes.
- Un rôle de conseil et d’alerte insuffisant ou inexistant, que ce soit auprès des dirigeants ou des responsables opérationnels.
Or, l’origine de ce constat vient souvent du fait que le rôle du contrôleur de gestion au sein des PTP En’est pas toujours clairement établi. Aussi, de plus en plus de contrôleurs de gestion de petites entreprises se plaignent de ne plus faire véritablement leur métier et d’être submergés par des responsabilités comptables et administratives de plus en plus lourdes, et qui n’ont pas de lien direct avec leurs compétences.
Une des principales raisons de cette situation, provient du fait que les dirigeants de PTPE ont souvent une vision erronée ou déformée de ce qu’est réellement le contrôle de gestion. Ce qui explique une incompréhension logique et légitime entre dirigeants et contrôleurs de gestion, qui s’avère désastreuse pour la pérennité des entreprises.
Le contrôle de gestion est, dans l’absolu, un mariage subtil et ordonné de méthodes et d’outils permettant aux dirigeants et responsables opérationnels de les aider dans leur prise de décisions quotidiennes, que ces dernières concernent le court ou moyen terme.
Pour être efficace, un système de contrôle de gestion doit donc avoir deux types d’approches différents, mais complémentaires :
- Une vision stratégique (soit à moyen ou long terme).
- Et une vision tactique (soit à court ou très court terme).
La première a pour rôle d’aider le chef d’entreprise à prendre du recul par rapport à son activité quotidienne, afin d’avoir une réflexion sur ce qu’il attend de son entreprise à moyen ou long terme(opportunités commerciales et/ou technologiques, investissements stratégiques à prévoir, évolution du savoir-faire de l’entreprise…).
La seconde doit avoir pour principal objectif d’aider le dirigeant (et les responsables opérationnels) à répondre notamment aux questions suivantes :
- Comment dois-je m’y prendre pour mettre en application mes décisions stratégiques ?
- Quels objectifs dois-je fixer à court et très court terme à mes responsables opérationnels(responsables de service, chefs d’équipe) ?
- Quels sont les moyens financiers nécessaires pour y parvenir ?
- Comment les obtenir rapidement et au meilleur coût ?
Dans la majorité des petites entreprises ayant un contrôleur de gestion – et il y en a beaucoup plus que l’on le pense –, on constate très souvent qu’une grande partie des tâches dites de « contrôle de gestion » s’apparente plus à des opérations de contrôles administratifs divers et variés, voire de secrétariat dans certains cas (validation des factures fournisseurs, contrôle des paiements reçus,rédaction de divers courriers administratifs et sociaux, gestion du standard téléphonique…). Certains vont même jusqu’à réaliser des tâches propres au métier de la comptabilité : saisies des écritures,audits des comptes, établissement de la liasse fiscale (bilan, compte de résultat, annexes), travaux d’inventaire, gestion de la trésorerie, déclarations fiscales, recouvrement des impayés…). Or,comptabilité et contrôle de gestion sont pourtant deux domaines très différents (même s’ils sont complémentaires) et ont chacun un but précis, ainsi que des règles de fonctionnement qui leur sont propres. De ce fait, il apparaît très dangereux de mêler les deux, sous prétexte de réaliser des économies substantielles – souvent d’ailleurs très discutables.
En effet, la comptabilité a principalement pour but de présenter, a posteriori, la situation comptable et financière de l’entreprise à un instant « t » (fin d’année ou fin de mois), et ce avec une vision patrimoniale et juridique de l’entreprise. En clair, cela revient à étudier l’activité de l’entreprise par l’intermédiaire d’un rétroviseur. Par opposition, le contrôle de gestion a pour but essentiel d’anticiper les principaux risques financiers futurs, en analysant avec une vision transversale, économique et commerciale l’activité passée et présente de l’entreprise.
Autrement dit, cela revient à analyser l’entreprise en regardant droit devant soi, avec une paire de jumelle, afin d’anticiper tout obstacle éventuel. Ces deux manières de voir l’entreprise s’avèrent donc fondamentalement différentes, mais pas antinomiques pour autant : elles sont simplement complémentaires. Sans comptabilité générale, il n’y a pas de contrôle de gestion efficace, dans la mesure où ce dernier doit pouvoir s’appuyer sur un système d’information de gestion (SIG) rigoureux et actualisé en permanence. Or, quel est le SIG minimum et obligatoire pour toutes les entreprises sans exception, si ce n’est justement la comptabilité générale ?
Le contrôle de gestion et L’analyse des écarts : cas de cellulose du Maroc
Cette partie introduit le contrôle de gestion d’ensemble des analyses des coûts préétablis ses objectifs,ses outils, Il a pour objectif de dégager l’articulation générale de la démarche. Pour le premier chapitres’intéresse au contrôle de gestion et l’analyse des écarts et contient trois sections dont la méthode de calcul du coût préétablies au sein de l’entreprise puis la deuxième section sur l’imputation rationnelle des coûts et la dernière section de la méthode ABC.
Pour piloter et prendre des décisions à court terme et long terme, le gestionnaire élabore et utilise de nombreux outils d’aide à la décision. Dans de très nombreux cas, il fonde ses décisions sur des démarches d’analyse de coûts. Il est donc indispensable de comprendre les conditions de validité des démarches mises en œuvre pour juger de la pertinence des coûts obtenus et des contextes dans lesquels ils représentent un réel éclairage pour la prise de décision.
Le questionnement sur les coûts est fondamental pour une entreprise dès qu’elle est en interaction avec des concurrents ou qu’elle s’interroge sur le prix acceptable par les clients lors de l’implantation sur un nouveau marché.
Construire un coût c’est effectuer un regroupement de charges autour d’un critère pertinent qui permette de répondre aux interrogations du décideur. Un coût est défini comme la somme des charges relatives à un élément défini au sein du réseau comptable.
Le choix des coûts à calculer se fait en fonction des activités de l’entreprise, de sa structure, de ses objectifs de gestion et de pilotage. Pour une période déterminée, un coût peut être calculé, soit en y incorporant toutes les charges enregistrées en comptabilité générale, soit en n’y incorporant qu’une partie de ces charges.
La méthode de calcul du coût préétabli
Coût préétabli : « coût évalué a priori soit pour faciliter certains traitements analytiques, soit pour permettre le contrôle de gestion par l’analyse des écarts. » (PCG 1982). La détermination de coûts préétablis permet à l’entreprise :
- De prévoir les coûts de la période suivante.
- D’évaluer rapidement une production.
- De contrôler les conditions d’exploitation par l’étude des écarts entre prévisions et réalisations.
justin
besoin d’ une formation en contrôle de gestion